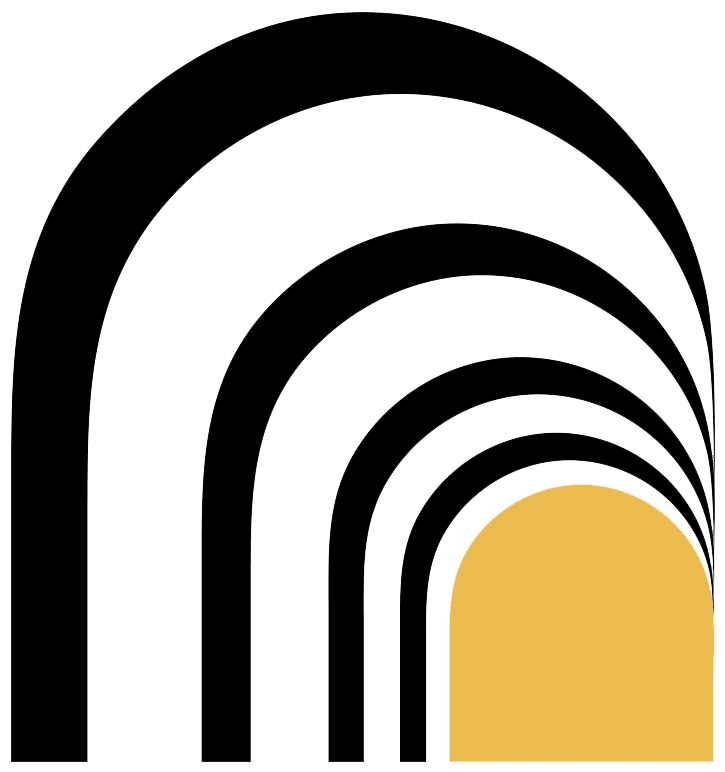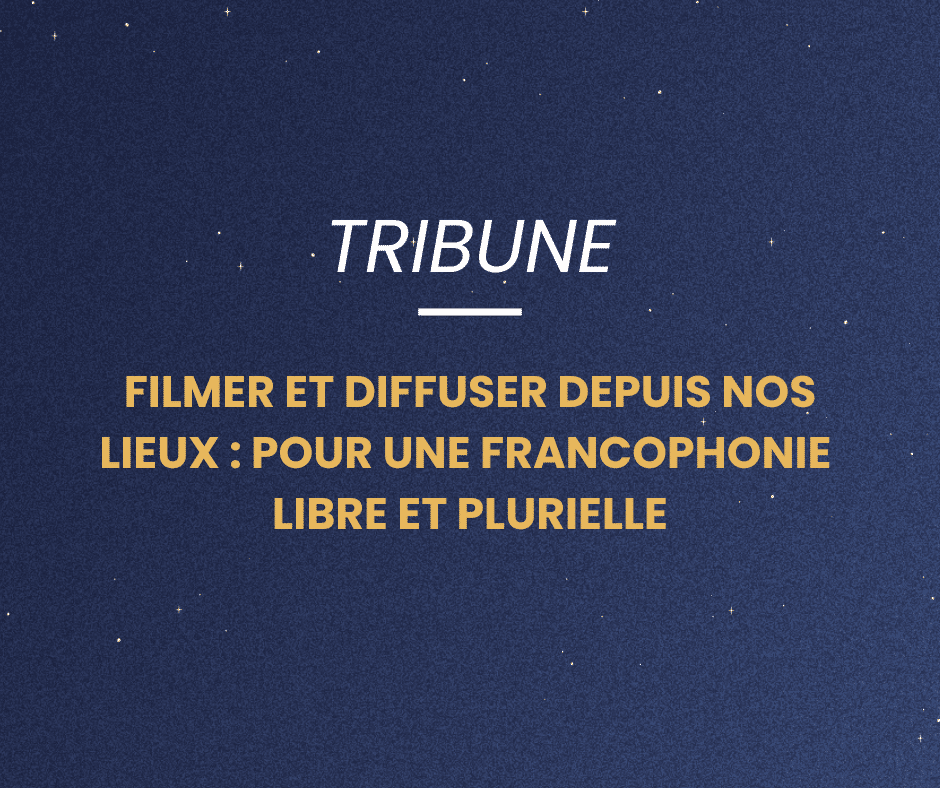À la veille des 21ᵉ Rencontres de Coproduction Francophone (RCF), qui se tiendront au Luxembourg du 28 au 31 octobre 2025, Laza, réalisateur, producteur et directeur de Madagascourt, et Philippe Gautier, fondateur et délégué général du Festival Films courts de Dinan, prennent la parole dans une tribune qu’ils ont corédigée, plaidant pour une francophonie libre, plurielle et ancrée dans les territoires.
À Dinan, ville d’Art et d’Histoire au cœur de la Bretagne, on mesure toute la valeur des passerelles entre les territoires francophones. Du 19 au 23 novembre, la cité accueillera la 8e édition du Festival Films courts de Dinan, avec plus de 100 courts métrages venus de tout l’espace francophone. Des regards venus d’ailleurs, et pourtant familiers. Des films qui ne cherchent pas à « parler de » mais à « parler avec ». Ce dialogue, nous voulons le prolonger hors de l’écran, dans la manière même dont nous concevons nos collaborations : horizontales, patientes, réciproques.
Cette édition marquera également le lancement de Dinan Film Pro, premières journées de rencontres professionnelles du court métrage francophone. Au menu : coproductions francophones, tremplin jeunes talents, IA générative, focus Madagascar, droit à l’image et pratiques du casting entre France et Belgique avec des tables rondes, des cartes blanches et des temps de networking qui favoriseront les échanges entre professionnels.
Un soir de projection à Dinan, un film venu d’Antananarivo arrachera des rires dans une salle pleine. Pas d’exotisme, juste une histoire de quartier qui parle à toutes et tous. C’est là que se joue la francophonie des territoires : libre, plurielle, située.
Nous plaidons pour une francophonie des territoires, qui ne se résume ni à une carte ni à une norme, mais s’invente au plus près des lieux, des langues et des imaginaires. Un jeune cinéma francophone émerge, ancré dans la réalité des quartiers, des villages, des côtes et des hauts-plateaux, de Dinan à Antananarivo, et c’est là que bat son cœur. Il porte une exigence simple et décisive : raconter nos histoires nous-mêmes, depuis nos territoires, avec nos voix, nos rythmes, nos contradictions.
Ce que nous apprenons de nos échanges, c’est que la vitalité du cinéma francophone ne se joue pas dans les grands studios, mais dans ces espaces de proximité, là où l’on se retrouve, caméra à la main, pour inventer ensemble des images justes et vivantes. Ce cinéma parle en accents, en créoles, en métissages. Il refuse l’uniformité et fait de la diversité un moteur narratif. Il tourne en court… mais il pense grand : ateliers dans les écoles, résidences d’écriture au bord de l’océan, collectifs qui mutualisent du matériel, micro-budgets qui libèrent l’audace. Raconter soi-même, c’est aussi reprendre la main sur les images qui nous définissent : sortir des récits importés, déplacer les regards, faire place aux vécus.
À Madagascar, près de 70 % de la population a moins de 30 ans (sources : Banque mondiale ; INSTAT). Cet esprit se concrétise déjà avec Ti’Kino gasy, notre version malagasy du mouvement Kino : faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. À l’horizon 2050, l’Afrique comptera 85 % des locuteurs francophones. (source : rapports de l’OIF).
Face aux tensions géopolitiques et aux fractures du monde, nous devons dès maintenant bâtir l’avenir ensemble. Il reste tant à faire pour rendre visibles les œuvres francophones, et plus encore pour soutenir la jeune création, trop souvent éclipsée dans nos territoires.
Les festivals, locaux comme internationaux, sont des maillons essentiels de cette visibilité. Mais ils affrontent aujourd’hui un triple défi : la diminution des soutiens publics, l’instabilité politique et sociale, et la concurrence d’un environnement médiatique saturé.
Pour que cette énergie s’inscrive dans la durée, il faut des passerelles plutôt que des centres : des coproductions inter-territoires, des circuits de diffusion qui relient salles, festivals et plateformes locales, des politiques publiques qui soutiennent l’émergence sans l’assigner, une gestion équitable des droits qui permette aux auteurs de vivre de leurs œuvres. La langue française n’y est pas une frontière mais une palette : on y ajoute, on y mêle, on y invente.
Lorsque Donald Trump menace de taxer à 100 % les films produits à l’étranger, ce n’est pas seulement une décision économique : c’est le symptôme d’un monde qui se replie. Face à cela, comment ne pas vouloir faire autrement ? Bâtir des circuits de coproduction francophones, solidaires et inventifs, aux côtés de la jeune génération, entre partenaires africains, maghrébins, français, québécois, belges, suisses et luxembourgeois. Comment ne pas être porté par l’envie de résister aux contenus massifs anglophones, en mettant en lumière la singularité de nos voix ?
Voyons cela comme une opportunité pour la création indépendante francophone.
Une francophonie « libre et plurielle » se mesure à sa capacité à accueillir les singularités et à leur offrir des moyens concrets : formation, équipement, traduction, sous-titres, circulation des films et des talents. Donnons à cette génération les outils de son autonomie, sans lui demander de rentrer dans le rang. Dans l’année qui vient, fixons-nous quatre gestes simples :
1. un appel à projets inter-territoires en binômes Nord–Sud ;
2. un circuit de diffusions locales synchronisées (salles, médiathèques, plateformes régionales) ;
3. un accord-cadre de gestion des droits garantissant un revenu plancher aux auteurs émergents ;
4. un fonds d’urgence et de résilience pour les festivals de cinéma francophone.
Encourageons les nouvelles voix du cinéma francophone qui explorent la diversité linguistique et culturelle avec tant de talent et d’originalité. Formons et fédérons les jeunes autour d’une culture cinématographique locale, mais ouverte sur le monde. Expérimentons sans attendre les autorisations. Ouvrons les portes : n’en fermons pas comme on peut le faire ailleurs.
C’est cette liberté que nous voulons défendre : un cinéma francophone qui n’imite pas les modèles dominants, mais qui en propose d’autres, ancrés, inventifs, solidaires. La francophonie qui nous inspire n’est pas une capitale : c’est un archipel. Relié par des voix, des images et des solidarités. À nous de tracer, ensemble, les ponts qui manquent pour filmer nos lieux.